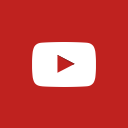La tyrannie du statu quo
Les désastres ne sont jamais le fruit du hasard, mais celui d’une architecture défaillante de la pensée. Pas plus hier qu’aujourd’hui, le matériel ne remplace l’audace stratégique. La France de 1940 possédait les chars, mais elle manquait de la doctrine pour les faire triompher. Ce constat résonne avec une actualité cinglante : alors que les menaces hybrides et technologiques se multiplient, l’Europe s’enferme encore trop souvent dans une gestion comptable et bureaucratique de sa sécurité.
L’enjeu fondamental est celui de la révolution copernicienne de notre défense. Se projeter vers l’avenir, c’est comprendre que la vitesse, la puissance et la surprise sont les seuls remparts contre l’effacement. L’ostracisme de la modernité est une menace qui frappe encore ceux qui proposent une rupture avec le suivisme ambiant. Si nous refusons de devenir les architectes de notre propre souveraineté, nous resterons les victimes d’une architecture conçue par d’autres. La leçon est claire : sans une volonté politique de mouvement, l’accumulation de moyens n’est qu’un sursis avant le prochain naufrage stratégique.