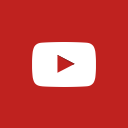Als direktes Echo auf unser Papier über ‚Die Große Ruptur‘, das die geopolitische Diagnose vom Ende der automatischen transatlantischen Übereinstimmung stellte, entschlüsselt dieser zweite Text von Jérôme Denariez brillant den taktischen Modus Operandi dieser neuen Ära. Der Autor lädt uns ein, die emotionale Lesart des ‚Trump-Stils‘ hinter uns zu lassen, um darin eine kalte Methode zu erkennen: das ‚nützliche Chaos‘.
Hier ist die Unberechenbarkeit keine Pathologie, sondern eine taktische Waffe, die darauf abzielt, den Raum zu sättigen, den Gegner zu lähmen und Unsicherheit in einen Verhandlungshebel zu verwandeln (Zölle, NATO).
Jérôme Denariez differenziert diesen Befund jedoch: Wenn auch diese Grammatik des Bruchs historische Vorläufer hat (von Nixons ‚Madman-Theorie‘ bis zu Roosevelts großem Knüppel), so personalisiert Trump sie doch bis zum Äußersten. Hierin liegt die vom Autor identifizierte Gefahr: Diese Schockstrategie bietet schnelle Gewinne, nutzt sich jedoch mit der Zeit ab, treibt China in die Autonomie und lässt die Verbündeten ohne Kompass zurück. Für Europa ist die Botschaft dieses Diptychons vernichtend: Angesichts eines Amerikas, das Unordnung zur Doktrin erhebt, reicht ‚juristischer Komfort‘ nicht mehr aus; man muss wieder in die Arena der Machtverhältnisse hinabsteigen.